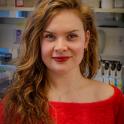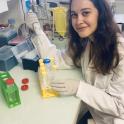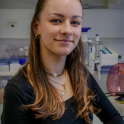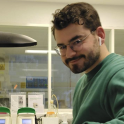Publié le 23.02.2026
Présentation
Le Laboratoire d’Hématologie de l’Institut Imagine se consacre à la fois à l’étude de la physiopathologie et au traitement des hémopathies malignes et bénignes. Il fait partie des unités de recherche INSERM U1163 et collabore étroitement avec le service d’hématologie clinique de l’Hôpital Necker, ainsi qu’avec les centres de référence nationaux pour la mastocytose (CEREMAST), les immunodéficiences (CEREDIH) et les hémoglobinopathies.
Depuis janvier 2025, le laboratoire est dirigé par le Pr Olivier Hermine et le Dr Thiago Trovati Maciel.
Nos objectifs principaux sont :
- Caractériser les mécanismes à l’origine des maladies hématologiques ;
- Développer des stratégies thérapeutiques innovantes ;
- Promouvoir la recherche clinique ;
- Favoriser le transfert de technologies.
Nous collaborons étroitement avec de nombreux services de l’Hôpital Necker, notamment l’anatomopathologie, la biologie, la cytogénétique, la biologie moléculaire, la biothérapie, les maladies infectieuses, la transplantation et l’hématologie immunologique pédiatrique.
Régulation de l'érythropoïèse et applications cliniques
Les globules rouges (GR) sont essentiels au transport de l’oxygène, et leur production (érythropoïèse) doit être finement régulée. Des maladies génétiques telles que la bêta-thalassémie et la drépanocytose (SCD) illustrent parfaitement les conséquences d’un dysfonctionnement de ce processus. Elles se caractérisent par une érythropoïèse inefficace et défectueuse, entraînant une anémie chronique et de graves complications affectant des millions de personnes dans le monde.
Notre laboratoire s’engage depuis de nombreuses années dans la compréhension et le traitement de ces maladies. Nous avons notamment joué un rôle pionnier dans le développement préclinique du sotatercept et du luspatercept, deux thérapies innovantes ciblant la voie de signalisation de la superfamille TGF-β pour restaurer une érythropoïèse efficace. Les bases conceptuelles et expérimentales établies dans notre équipe ont été déterminantes pour amener ces molécules en essais cliniques, conduisant à leur utilisation thérapeutique dans la bêta-thalassémie. Ce succès translationnel illustre notre capacité à faire passer des découvertes fondamentales vers le soin des patients.
Nos projets actuels prolongent ces efforts à travers plusieurs approches complémentaires :
- Régulation moléculaire de l’érythropoïèse : nous étudions le rôle des caspases, du métabolisme de la sérotonine et de l’axe TGF-β1 dans la différenciation érythroïde. Leur dérégulation contribue de manière majeure à l’érythropoïèse inefficace des maladies génétiques du sang.
- Déterminants génétiques des maladies des globules rouges : grâce à des études génomiques et fonctionnelles, nous identifions de nouveaux défauts génétiques modifiant l’érythropoïèse, ce qui permet d’expliquer la variabilité des manifestations cliniques et d’ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques.
- Innovation thérapeutique : forts de notre rôle dans le développement du luspatercept et du sotatercept, nous explorons d’autres stratégies pour corriger l’érythropoïèse défectueuse, notamment via des approches pharmacologiques ciblant les réserves intracellulaires de fer ou les réseaux transcriptionnels érythroïdes. Nos collaborations avec l’industrie garantissent une traduction rapide de ces découvertes.
- Lien entre érythropoïèse et immunité innée : au-delà de la biologie des globules rouges, nous étudions l’implication des voies inflammatoires et des cellules immunitaires — en particulier les mastocytes— dans les complications de la drépanocytose. Ces travaux sont directement intégrés au projet RHU Sickmast, qui explore conjointement régulation immunitaire et érythropoïèse.
En combinant recherche fondamentale, génétique et innovation thérapeutique, notre laboratoire continue de faire progresser le domaine de l’érythropoïèse. Nos contributions pionnières au sotatercept et au luspatercept illustrent le potentiel transformateur de notre démarche, avec l’ambition de développer la prochaine génération de traitements pour les patients atteints de bêta-thalassémie, de drépanocytose et d’autres anémies héréditaires.
Immuno-Oncologie
Notre laboratoire explore également les interactions entre immunité, inflammation et cancer. Certains de nos projets étudient comment les déficits immunitaires génétiques prédisposent à des lymphomes rares, ou comment certaines maladies auto-immunes comme la maladie cœliaque peuvent évoluer vers des désordres lymphoprolifératifs.
Axes de recherche :
- Constitution d’une des plus grandes bases de données de patients présentant des erreurs innées de l’immunité associées à des complications malignes, en collaboration avec des réseaux nationaux ;
- Développement de thérapies ciblées, incluant anticorps et approches CAR-T, pour traiter les lymphomes intestinaux et autres localisations ;
- Utilisation de modèles comparatifs (par exemple, lymphomes gastro-intestinaux félins) afin de mieux comprendre les mécanismes pathologiques.
Bien que rares, ces pathologies représentent des besoins médicaux non satisfaits. En intégrant immunologie, oncologie et hématologie, nous développons des approches thérapeutiques innovantes adaptées au contexte génétique et moléculaire de chaque maladie.
Mastocytose et maladies liées aux mastocytes
La mastocytose est une maladie rare et hétérogène, causée dans la plupart des cas par des mutations du récepteur KIT. Elle entraîne une accumulation et une activation anormales des mastocytes, cellules immunitaires impliquées dans les réponses allergiques et inflammatoires.
Grâce au centre de référence CEREMAST, notre laboratoire dispose de données cliniques provenant de plus de 2 000 patients, constituant la plus grande base européenne sur cette maladie. Cette ressource unique nous permet de :
- Étudier comment les mutations de KIT coopèrent avec d’autres anomalies génétiques pour aggraver la sévérité de la maladie ;
- Identifier de nouvelles voies moléculaires (comme la voie hedgehog ou l’apoptose médiée par FAS) ciblables pour de futurs traitements ;
- Tester de nouvelles stratégies thérapeutiques, incluant inhibiteurs de tyrosine kinase et combinaisons visant à surmonter les résistances ;
- Explorer les formes héréditaires de mastocytose par des études familiales, afin d’identifier de nouveaux gènes en cause.
Au-delà de la mastocytose, nous analysons également le rôle des mastocytes dans d’autres maladies, allant des pathologies auto-immunes et allergies aux cancers. Cette vision élargie souligne l’importance des mastocytes comme acteurs clés de la santé et de la maladie.
Focus sur le projet RHU Sickmast
L’un de nos projets phares est le projet RHU Sickmast, financé dans le cadre du programme français “Recherche Hospitalo-Universitaire” (RHU). Cet effort ambitieux et pluridisciplinaire est coordonné par le Pr Olivier Hermine, avec le Dr Thiago Trovati Maciel comme directeur scientifique et et les Professeurs Slimane Allali et Jean-Benoît Arlet comme directeurs de la partie clinique.
Le défi
La drépanocytose (SCD) est l’une des maladies génétiques les plus fréquentes dans le monde. Elle est causée par une mutation du gène de l’hémoglobine, entraînant une érythropoïèse défectueuse et des globules rouges anormaux, responsables d’anémie chronique et de crises vaso-occlusives douloureuses. Ces crises sont non seulement potentiellement mortelles, mais altèrent aussi fortement la qualité de vie. Malgré des progrès, nombre de complications restent imprévisibles et difficiles à contrôler.
Notre hypothèse
Traditionnellement considérée comme une maladie des globules rouges, la drépanocytose semble aussi fortement liée à l’immunité. Nos travaux récents suggèrent que les mastocytes — cellules connues pour leur rôle dans les allergies et l’inflammation — jouent un rôle central dans les complications aiguës et chroniques de la maladie. Nous avons montré que certains médiateurs mastocytaires sont fortement augmentés lors du syndrome thoracique aigu, l’une des complications les plus graves, ce qui désigne l’activation mastocytaire comme un moteur potentiel de la progression de la maladie.
Objectifs de Sickmast
Le projet RHU Sickmast vise à :
- Constituer une vaste base de données cliniques et biologiques de patients drépanocytaires, en partenariat avec le réseau translationnel et le Labex GR-Ex ;
- Identifier des biomarqueurs d’activation mastocytaire corrélés aux complications aiguës et chroniques, afin de mieux prédire le risque et intervenir précocement ;
- Développer de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant les mastocytes et leurs médiateurs (par ex. inhibiteurs de tyrosine kinase) ;
- Conduire des études précliniques et cliniques pour évaluer ces approches et leur capacité à prévenir les crises vaso-occlusives, réduire l’inflammation et améliorer la prise en charge.
Impact
En redéfinissant la drépanocytose non seulement comme une maladie des globules rouges mais aussi comme une maladie immuno-médiée, le projet Sickmast pourrait transformer la prévention et le traitement des complications. Au-delà de l’amélioration de la qualité de vie des patients, ce projet génèrera une propriété intellectuelle précieuse et favorisera les collaborations avec l’industrie, garantissant une traduction rapide des découvertes vers la clinique.

Equipe
Ressources & publications
-
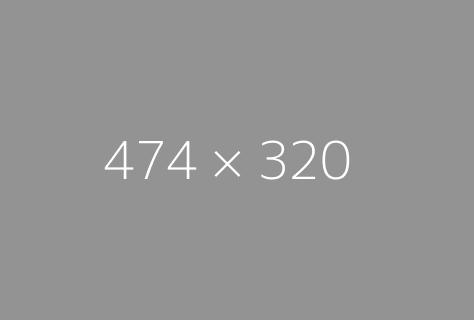 2020Journal (source)Leukemia
2020Journal (source)LeukemiaTargeted deep sequencing reveals clonal and subclonal mutational signatures i...
-
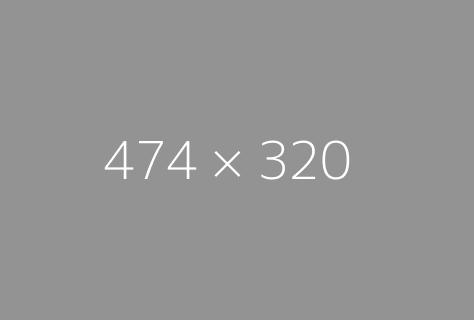 2020Journal (source)Haematologica
2020Journal (source)HaematologicaInnate immune cells, major actors of sickle cell disease pathophysiology.
-
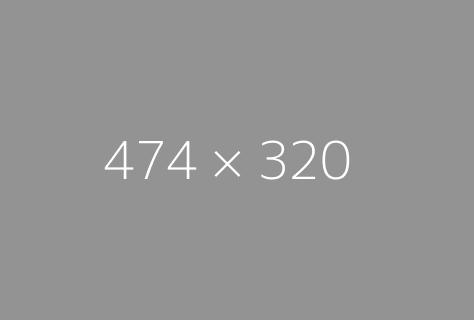 2020Journal (source)Front Microbiol
2020Journal (source)Front MicrobiolNovel Treatments of Adult T Cell Leukemia Lymphoma.
-
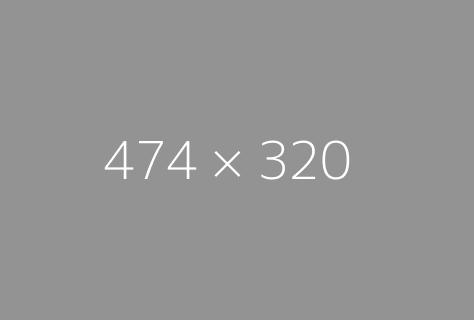 2019Journal (source)Cell Rep
2019Journal (source)Cell RepEnhanced Renewal of Erythroid Progenitors in Myelodysplastic Anemia by Periph...
-
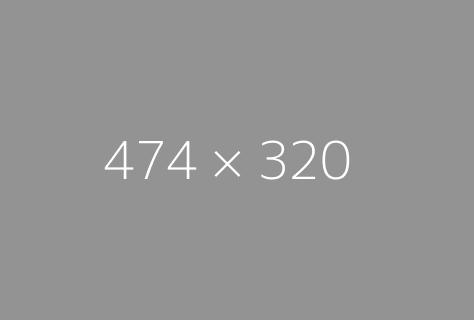 2019Journal (source)Haematologica
2019Journal (source)HaematologicaXPO1 regulates erythroid differentiation and is a new target for the treatmen...
-
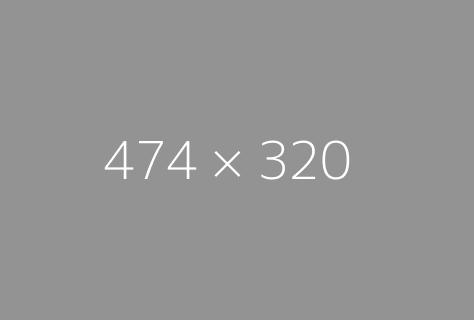 2019Journal (source)Haematologica
2019Journal (source)HaematologicaA novel, highly potent and selective phosphodiesterase-9 inhibitor for the tr...
-
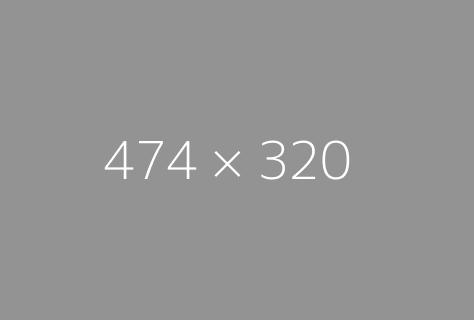 2019Journal (source)F1000Res
2019Journal (source)F1000ResRecent advances in the understanding and therapeutic management of mastocytosis.
-
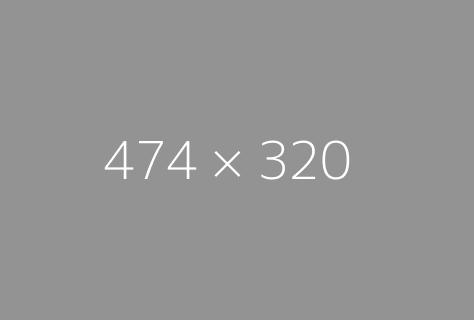 Journal (source)J Allergy Clin Immunol Pract
Journal (source)J Allergy Clin Immunol PractNeuroinflammatory disorders and mastocytosis: A possible association?